| |
|
|
"La critique est entre les mains d'une vingtaine de saligauds
qui ne louent que les copains dans leur genre.
Je crois que le dimanche ils cambriolent ensemble
des tôles dans la banlieue.
Rien n'unit les gens comme le crime."
Fernand Fleuret, lettre à Ch. Th. Féret.
C'est Gabrielle Réval qui incite son époux à s'essayer au roman, genre pour lequel il n'a, a priori, aucune inclination : "Je suis talonné par la N.R.F. et par ma femme. Ah! j'ai horreur de la besogne commandée, du métier d'homme de lettres, le plus infâme et le plus ridicule de tous, et en particulier du roman, genre faux et anti-littéraire, s'il n'est pas le résultat de plusieurs années de mise au point et d'écriture. J'aime mieux les vers. C'est ma langue naturelle. Du moins, je l'écris en me jouant, en m'amusant et n'importe à quelle heure du jour." Mais, aussi flatteuse que soit l'estime des lettrés et des poètes, elle ne nourrit pas son homme. Ce sont les romans qui désormais, en ces temps de publicité et de prix littéraires, apportent la gloire littéraire et l'aisance financière.
Fleuret a plus que jamais besoin de stabilité. S'il affecte des allures de dandy et impressionne Mac Orlan par "la rare élégance de ses complets" (Les Mystères de la Morgue), s'il se montre un ami plein de charme et fascine par son érudition et sa conversation, il parvient de moins en moins à dissimuler le chaos qui l'habite : "Moi, je ne me reconnais plus. Je n'ai plus qu'un vague souvenir de ce que je fus. Je voudrais mourir à présent. (...) C'est un drame navrant que de ne plus se reconnaître." Alors, aux longues journées studieuses et solitaires passées à la Bibliothèque Nationale succèdent des nuits de beuverie et de débauche, ou d'étranges et violentes virées en compagnie d'amis.
Un de ses compagnons de brinquebale est maître Maurice Garçon, avocat lettré, féru d'occultisme et dépourvu de tout esprit de sérieux : "A-t-il trente ans, en a-t-il passé quarante, c'est ce que je ne saurais dire, depuis près de vingt ans que je le connais. Il y a même des jours où nous en avons chacun douze : c'est quand nous jouons avec les armes à feu, les arquebuses, les pistolets, les fusils... et les canons." En compagnie du R.P. Bénédictin, Fleuret et Garçon, armés à eux trois d'une carabine, de deux pistolets de précision et de deux pistolets de combat, mitraillent bouteilles vides et "quelques douzaines de grenouilles qui faisaient du nudisme au soleil. "Je ne tire pas trop mal pour un Nom de Dieu de moine?" dit le P. Bénédictin."
Fleuret se plaît à accompagner Garçon et un autre avocat, Maître Jacob, "qui sait le latin comme Virgile et le langage chien comme Anubis", lorsqu'ils partent plaider en province. En pleine nuit, leur voiture file à 110 sur les routes de campagne, fracassant les barrières des passages à niveau. Maurice Garçon "n'arrête pas de parler et lâche le volant pour les gestes du barreau." A Guérande, Jacob et Fleuret réquisitionnent l'orgue de l'église et, pour le plaisir de choquer les paroissiennes, y jouent le Don Juan de Mozart puis une Marseillaise "tonitruante et démoniaque". Ailleurs, Jacob "se transforme soudainement en mendigot (...) Il chante, le plus faux possible : Sois bonne, ô ma chère inconnue!...Les sous pleuvent des fenêtres. Il les ramasse. "Merci, M'ssieurs Dames!..." Et il s'éloigne, d'un pas normal, en allumant une cigarette."
Un soir à Paris, après dîner, Fleuret, Garçon, La Fouchardière et Tristan Derème décident qu'il leur faut absolument disputer une partie de boules. Les voilà donc Avenue du Bois, "cinq innocents dont une dame, qui faisons rouler nos boules en nous interpellant par nos noms." Les badauds s'attroupent et le dessinateur Sem rejoint la partie. Un gardien surgit : il est interdit de se livrer à ces jeux Avenue du Bois. Maître Maurice Garçon demande à voir le règlement. On le consulte à la lueur des briquets : "Il y a le cerceau, le volant, le croquet, le ballon, le vélocipède, le saut à la corde, le saute-mouton, le colin-maillard, les pâtés, la brouette, les
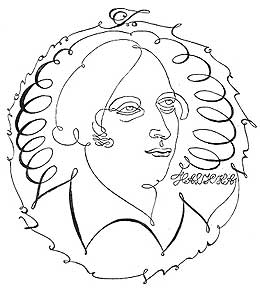 |
|
Fleuret, calligraphie de Halicka, 1925
(tous droits réservés)
|
|
échasses, enfin, tout ce qu'il y a de chouette, sauf les boules." "Emmenez-nous au poste!" exige La Fouchardière. Le garde ne peut qu'accepter : "Et nous lui emboîtons le pas, suivis de trois cents badauds qui s'amusent et crient vive l'un, vive l'autre. "C'est-y pas malheureux, soupire le bon garde, d'avoir fait quatre ans de guerre, d'avoir perdu un bras et d'être emmerdé par des gens bien, qui feraient mieux d'aller boire des fines!..." Tous les incidents ne se finissent pas aussi bien car Fleuret a le vin sombre et l'ivresse agressive.
Malgré les amis, malgré les divertissements, malgré l'alcool, la mélancolie pèse chaque jour un peu plus sur les épaules de Fleuret. Vingt ans de travail n'ont produit que quelques plaquettes de vers, une poignée de préfaces et de commentaires, que la critique a soigneusement évités. Fleuret repousse les consolations de Féret. Il ne croit plus à une quelconque reconnaissance de son talent : "Non, mon cher Féret, je n'aurai aucun succès." Il ne trouve guère de réconfort qu'auprès de sa mère qui, depuis son mariage, est venue habiter avec lui. L'arrangement n'est sans doute guère agréable pour Gabrielle Réval. Peu à peu le couple s'est désagrégé. A l'indifférence du mari volage répond la jalousie de l'épouse vieillissante. Il n'est pas cependant question d'une séparation : "Je me suis juré, écrit Fleuret à Féret, de ne pas l'abandonner, malgré tous ses torts, ses duretés et ses faiblesses. Elle sentait que le déclin de sa vie sentimentale touchait à son terme, et ce terme était la mort physique et morale. Ce n'est pas moi qui déchaînerai l'orage." Gabrielle ne veut pas, elle non plus, renoncer à son combat pour protéger Fleuret de lui-même mais, de guerre lasse, elle passe de plus en plus de temps loin de son mari dans sa villa du Midi ou dans des stations thermales. Avenue Mercédés, pour se distraire, Fleuret tire les pigeons au pistolet, ce qui n'amuse pas les voisins. La nuit, des voix désincarnées lui parlent, qui l'empêchent de dormir. A son vieux confident, Ch. Th. Féret, il écrit : "Je suis détaché du désir de la gloire et je ne fais plus de cas pour moi du métier d'écrivain. Comme l'a dit Mary en un rondeau, je Berce un coeur mort à la gloire, à l'amour."
Publié par la N.R.F. en 1924, Les Derniers Plaisirs n'ont demandé à Fleuret qu'un mois et demi de travail. Il y raconte l'histoire d'Alvare, fils de Don Juan Manara, qui expie, dans un monastère de Séville, les crimes du père qu'il a tué. Don Juan, vieillissant, espère se survivre à travers son fils. Et c'est un soir que, dissimulé dans la chambre d'Alvare et de sa jeune épouse, il joue les voyeurs, qu'il trouve la mort. "Alvare le Poète, explique Fleuret, éloigné de tout ce qui n'est pas la Poésie, c'est à dire la création de son esprit contemplatif, (...) est bien seul avec lui-même, et il ne peut rien aimer que lui-même et sa Mère, la Poésie. Finalement il triomphe de la contrainte en tuant son père, et le cloître signifie qu'il ne vit plus qu'en lui-même, qu'il a renoncé à toutes choses."
Fleuret choisit comme décor l'Espagne du siècle par pudeur. Le fond de sa narration lui semble en effet "trop personnel et trop intime". Les tourments d'Alvare, pris entre l'Idéal et la Chair, entre la spiritualité et la sensualité, agitent aussi Fleuret : "C'est en révisant le plan de ce livre au moment de prendre la plume que je me suis aperçu de son étroite parenté avec le drame moral qu'est la vie d'un poète et particulièrement la mienne."
Sa femme et ses amis poussent Fleuret à se porter candidat aux prix Goncourt. Il est assuré du soutien d'Elémir Bourges (1852-1925), qu'il a connu du temps de Guillaume Apollinaire. Dans un petit appartement rue du Ranelagh, Bourges et Apollinaire "parlaient ensemble avec passion des derniers Nick Carter, que Guillaume achetait régulièrement et dont profitait Elémir Bourges, grand lecteur d'Alexandre Dumas, de Victor Noir et de Paul Féval." Fleuret se sent en sympathie avec ce lecteur au long cours qui avoue : "Je n'ai guère écrit que trois livres d'abord parce qu'il faut se reposer sept ans quand on a le sentiment que l'on a fait quelque chose de bien, ensuite parce que j'ai le travail difficile, et, enfin, parce que j'ai la passion de la lecture. A la Bibliothèque de Versailles, j'ai relu trois fois Saint-Simon tout entier; ça prend du temps!..." Elémir Bourges n'aime pas plus son époque et ses contemporains que Fleuret, et n'a pas de mots assez durs pour les fustiger. Il élève, écrit Fleuret, la scatologie "jusqu'à l'épique (...) parce qu'elle représentait pour ce grand pessimiste l'injure la plus comique par laquelle il rabaissait et bafouait l'humanité contemptrice des dieux, des héros et des poètes."
Bourges, quoique très malade, tient parole et, par correspondance, vote pour Les Derniers Plaisirs au premier tour de scrutin, et lors des six tours suivants. Mais il est le seul et le prix Goncourt 1924 vient récompenser Le Chèvrefeuille de Thierry Sandre, membre de l'Association des Ecrivains - Combattants. Lorsque Fleuret se rend rue du Ranelagh pour le remercier, Elémir Bourges vient de mourir lui laissant en dernier cadeau un Keats et un Casanova, et un sage conseil : "Mon petit Fleuret, ce qui peut nous consoler, c'est que dans trois cents ans, il se trouvera bien un vieil imbécile pour déterrer nos livres sous la poussière des bibliothèques et parler de nous en commettant les erreurs biographiques les plus amusantes."

|
|
|

